| � |
  LES
ENJEUX LES
ENJEUX
  LES
ORGANISATEURS LES
ORGANISATEURS
  LES
DEUX PHASES LES
DEUX PHASES
  LES
PARTICIPANTS LES
PARTICIPANTS
  PROGRAMME PROGRAMME
 PREVISIONNEL PREVISIONNEL
  ANNUAIRE ANNUAIRE
  PLAN
DU SITE PLAN
DU SITE
  CONTACT CONTACT
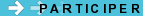
�
|
� |
visites sur le terrain et ateliers de r�flexion
ALSACE
Du brouillard dense. Tellement dense qu�on a l�impression d�arriver au bout du Monde. Heureusement, les petites fl�ches bleues marqu�es " Planet�ERE 2 " �parpill�es � travers la ville d�Obernai, � mi-chemin entre Colmar et Strasbourg, nous emm�nent droit au but. La foule amass�e dans le hall du grand b�timent beige, est Plan�taire ! Le Malien, le Qu�b�cois, le Rwandais, le Belge, l�Allemand, le Fran�ais sont accueillis par Marielle Billy, Olivier Duquenois, Jean-Claude Schwartz & Co, les gentils organisateurs, "cocheurs" mandat�s par l�ARIENA.
Dix heures sonnantes, Heide Bergmann, directrice de l�Ecostation de Fribourg, donne le ton : " Notre mission : enthousiasmer les enfants d�aujourd�hui pour convaincre les adultes de demain et prot�ger la nature du futur." Les Qu�b�cois de rench�rir : " Chez nous, les enfants, c�est jusqu�� 30 ans ! Et qu�on soit jeune ou pas, faut dire qu�on n�a pas beaucoup d�efforts � fournir dans nos reins pour se convaincre de l�utilit� de l��ducation � l'environnement. Depuis toujours, on se bat pour la survie de notre langue, la survie de notre sp�cificit�, la survie de notre environnement, la survie de notre plan�te." " En clair, au Qu�bec, vous �tes tous �colos ! " r�torque Patrick Barbier, pr�sident d�Alsace Nature. " Oh ! On est tr�s loin de la perfection ! " Jean-
Claude Rodriguez, de l�OCCE 67, peu convaincu, les interroge : " pour nous fran�ais votre r�seau d��ducation � l'environnement est exemplaire, alors d�tes-nous, quel est votre secret ? " Et Alain P�lissier de r�pondre : " Nous, on ne s�enfarge pas dans les fleurs du tapis. Le r�seautage, c�est vital pour nous, et �a prouve l�importance de la soci�t� civile. "
Petite pause pour accueillir la d�l�gation belge. C�est au tour des pays du Sud de prendre la parole� Cheik Mohamed Thiam du Mali attaque : " A quoi �a sert de vouloir emmener les enfants trop loin de l��cole ? Chez nous, on ne peut pas, �a co�te trop cher et �a ne sert � rien de vouloir montrer l�exception. L��ducation � l'environnement peut aussi se faire entre quatre murs. Il faut se servir de l�exp�rience des enfants. " Et Jean Bosco Runyota, du Rwanda, d�ajouter : " Et comment feriez-vous si vous �tiez confront�s � une population non alphab�tis�e � plus de 50 % ? " Les r�ponses fusent et chacun y va de sa solution. Pour Mayotte, il faut privil�gier l�oral, pour Madagascar, les m�diateurs, pour le Maroc, les images et pour le Mali, les radios locales. Et la Suisse de conclure : � Wer die Schule hat, hat er das Land : celui qui poss�de l��cole, poss�de le pays �.
Aude et val�rie
BRETAGNE
La premi�re journ�e fut bien remplie� Surtout pour l��quipe de r�daction dont je fais partie� Le 1er num�ro de la gazette locale � Le Petit Report�ERE � est enfin l� ! (les ordinateurs nous font toujours des surprises !)
Nous y sommes ! Planet�ERE 2 est lanc�.
Depuis dimanche matin, nous sommes environ 90 � Belle Isle-en-Terre. Lors de la c�r�monie d�ouverture, on pouvait ressentir l�envie d��changer, de partager les exp�riences.
Un m�lange d�accents, de cultures, assaisonn� d�une pointe d�exotisme ; les contacts se sont �tablis, la journ�e s�est poursuivie� Notre premier repas bio �tait d�licieux� Puis, d�part en minibus, � la d�couverte d�exp�riences p�dagogiques favorisant le lien homme-territoire : une exploitation durable ouverte au public, une base nature g�r�e par un comit� de quartier, des techniques douces de p�che � pied, une structure d�accueil attentive � ses �conomies d�eau, un espace naturel, des landes � biodiversit�s ��
M�me pas fatigu�s, apr�s notre 2�me repas bio, le forum, des pas de danse endiabl�s et quelques bi�res (il faut le dire) se sont encha�n�s�
Aujourd�hui, les yeux un peu fatigu�s, d�butent les r�flexions, et les �changes sur les bilans nationaux...
F�licie Galelli
CENTRE
Bree ... Quel froid !
Hier (17 :11), le thermom�tre affichait �2�C � Orl�ans. Mais c��tait avec chaleur et fraternit� que les compatriotes de Jeanne (d�Arc) ont accueilli les d�l�gations canadiennes, burkinab�es, mauriciennes, nig�riennes, rwandaises et malgaches.
Pour ce premier jour de la phase 1 de Planet�ERE, � tous ces organisateurs orl�anais :
Barka ! murakoze ! nagode ! misaotra ! merci !
Et � dans quelques jours � Paris
Mascime de Madagascar
LANGUEDOC - ROUSSILLON
Br�ves de Montpellier
M�t�o : pluvieux, mais chaleureux
Coup de houle : Ca a pitonn� dans l�atelier � projet � de l�APIEU, 30 disparus selon la police, Kouami Kokou retrouv� selon les organisateurs.
Kikadikoi ? � Le maire et les � Comment vous d�tes en fran�ais ? � les administr�s. Je suis pas habitu�e � la d�centralisation politique fran�aise. �
Yvonne, B�nin
� Journ�e int�ressante et enrichissante, mais courte. Il nous faut 48h sur 24 pour pouvoir faire le programme �tabli. �
Aude-l� des mots
Au rendez-vous du samedi soir, on n�est que 12 mais d�j� on s�enrichit, on discute et on savoure nos prochains �changes : malgaches, indiens, qu�b�cois, s�tois, narbonnais, montpelli�rains�
Attention, dimanche, prenez cir�s et K-way : avis de pluie � Durban !
Mais non, la seule douche que l�on prend est celle des rayons de soleil et des mots. Des mots pour construire ensemble la rivi�re, des mots pour l�expliquer, des mots pour la comprendre mais aussi pour la ressentir.
Cinq mots sortis de la t�te et ma voisine devient po�te.
Petit �chantillon :
Si j��tais la rivi�re�
J�aimerais que l�on s�inqui�te de moi
J�aimerais tous ces gens l�-haut dans la lumi�re qui joue avec les cailloux
J�aimerais leurs yeux brillants comme devant un tr�sor quand ils s�amusent � me recr�er.
J�aimerais l��change qu�il y a entre eux, leurs accents et leurs belles histoires
Si j��tais la rivi�re, je serais joyeuse aujourd�hui.
Et comment �crire ce repas qui conduit � sa cuisine tout en douceur, en gentillesse, en odeur et go�t. Saveur Orientale nous offre un repas � respect et d�couverte � : escalope de c�r�ales accompagn�e de crudit�s, riz � l�indienne et ses petits l�gumes, fromage blanc au gingembre, tcha�.
Profitons de l�astre solaire bien pr�sent pour parcourir pour les uns le sentier botanique guid�s par les enfants et pour les autres le jardin botanique.
La garrigue se voit - d�chiffrons ce paysage -, se sent - froissons un brin de thym -, s�entend - tendons l�oreille � la grive qui tchatche -, se goutte - m�chons cette baie de cade -, se touche - A�E !
Mais la garrigue se comprend : sec, hiver doux, pastoralisme, crue, calcaire, jardin bio-dynamique�
Puis quelques paroles �chang�es sur le v�cu de chacun et aussi sur livres et documents que chacun tripote.
En bus, nous sommes rentr�s, un repos m�rit�, un film prim� (Festival International du Film sur les Insectes) pour une journ�e termin�e.
Lundi 18 novembre, tout le monde (on est maintenant une trentaine) va sur l��le de Sainte-Marie en bord de mer.
Matin�e vent�e sur le terrain, mais aussi d�bats durant lesquels les th�mes de Planet�ERE2 (mobilisation, coop�ration, chartre et strat�gies internationales) sont de plus en plus pr�sents. Tout cela nous pr�pare aux Grandes Retrouvailles.
A bient�t� A Paris !
PICARDIE
Site de Vervins
Dans notre belle r�gion si verdoyante o� il r�gne en ce moment un froid quasi sib�rien ce matin, nous avons eu la chance, en nous rendant sur le terrain, d�observer, puis de laisser passer devant nous, une bande de 16 sangliers de tout �ge. Comme quoi, l�organisation a �t� super bien pr�vue !
Avant de partir pour cette visite, l�exploitation du lyc�e agricole a �t� pr�sent�e durant environ 1 heure, par M. Gruselle, chef d�exploitation.
Ce dernier nous a pr�sent� les diff�rents ateliers sur cette exploitation (ateliers �nonc�s dans Courant d�ERE du 18 novembre 2001), ainsi que la ma�trise des effluents d��levage, et la mise en place de CTE (Contrat Territorial d�Exploitation).
Puis nous sommes partis sur l�exploitation de Mr Halleux qui, fait surprenant , abandonne les cultures pour remettre les terres en p�ture (sur 20 ha cette ann�e), et r�implante des haies autour des parcelles. Il ne s�agit pas d�une exploitation marginale, mais d�un GAEC dont les membres sont particuli�rement impliqu�s dans la profession agricole, Chambre d�Agriculture, CUMA�) et s�est engag� dans un CTE (Contrat Territorial d�Exploitation).
Cette visite a �t� conclue par la d�gustation de Maroilles fermier (produit du terroir typique de la Thi�rache), fabriqu� et affin� sur cette exploitation, gr�ce au lait de la traite du matin.
M�me si nous n�avons pas encore mis en forme les fiches r�capitulatives, les repas, longs moments de d�tente et de convivialit�, repr�sentent un temps fort d��changes entre les participants, qu�ils viennent du Qu�bec, du Burkina Faso, d�Alg�rie, de Syrie, de Belgique, de Madagascar ou m�me de France.
Pour cette fin de journ�e, �changes pr�vus avec des enseignantes de primaires, et d�ner d�bat avec des agriculteurs sur les diff�rentes pratiques agricoles (agriculture raisonn�e, durable, biologique, le r�seau FARRE, la mise en place de CTE), et les liens agriculture-environnement.
Nous pr�parons d�s maintenant la liste de nos courriers mail, pour que chacun puisse en disposer. Les fondations sont d�ores et d�j� pos�es pour assurer le devenir de nos �changes de demain.
Pour le site Picardie B-Agriculture
POITOU - CHARENTES
Lundi 19 au soir : deux interventions sur la participation citoyenne, "table ronde" anim�e par Thierry Thomas, journaliste au Moniteur.
Apr�s l'exp�rience br�silienne du budget participatif pr�sent�e le matin (chroniqu�e dans courant d'ERE n�7), deux interventions r�gionales ont contribu� � la r�flexion sur la participation citoyenne.
Monsieur Dulait, s�nateur, vice-pr�sident du Conseil G�n�ral 79 et maire de M�nigoute, a pr�sent� une exp�rience men�e sur sa commune et inspir�e des bureaux d'audience publique pratiqu�s en Am�rique du Nord. Il s'agissait d'associer la population tr�s en amont � la r�flexion autour d'un projet de stockage de d�chets m�nagers. Finalement le projet a �t� invalid�, notamment au vu des r�sultats de l'�tude g�ologique. Cependant, le processus d'audience publique a permis de d�montrer qu'on peut organiser une participation qui ne soit pas qu'un alibi. Elle a �galement eu la vertu de faire �voluer certaines positions (de l'opposition radicale � la demande de plus de pr�cautions).
Laurent Fonteneau, adjoint au d�l�gu� r�gional de l'environnement, a insist� sur la diff�rence entre participation subie ou alibi (lorsqu'un projet d�j� ficel� est parachut� localement) et participation anticip�e, qui doit pr�parer la r�flexion sur un projet et qui peut poser la question de son opportunit�. Mais �galement sur la diff�rence entre int�r�t particulier et g�n�ral, entre court terme et long terme� Il a �galement soulign� la grande difficult� de la mise en �uvre de ces d�marches (qui ne consistent pas simplement � mettre dans une m�me salle les "pour" et les "contre"�) et la n�cessit� de former de v�ritables m�diateurs. Ces m�diateurs, issus de la soci�t� civile, doivent rassembler les qualit�s d'expertise et d'ind�pendance.
L'enjeu est de cr�er une culture de pratique sociale nouvelle autour de la participation. C'est une d�marche � mettre en place dans le moyen terme avec un processus de veille, d'observation et d'�valuation, pour en ajuster la m�thode.
Si on peut regretter que le d�bat qui a suivi n'ait pas permis d'ouvrir la r�flexion sur une dimension internationale, il a tout de m�me fait ressortir quelques id�es int�ressantes. Les �lus sont finalement les "salari�s" des citoyens. Les entreprises sont aussi de bons lieux pour travailler sur la dimension de participation citoyenne dans le domaine de l'environnement.
L'�ducation � l'environnement, c'est aussi apprendre � lire sur les �tiquettes de nos produits de consommation. La participation active des citoyens, si elle se con�oit bien sur un projet local semble plus d�licate � mener sur un projet d'envergure nationale, la participation citoyenne impose aussi des changements dans les pratiques des administrations (et dans le r�le des experts).
Une remarque pour ouvrir la porte � un autre d�bat : on a parl� ici que de "participation descendante" des citoyens dans le cadre de projets propos�s par la collectivit�, or il semblerait int�ressant de s'int�resser aussi � une forme de participation, o� la population est � la base du projet � d�battre, et qui serait une "participation ascendante".
Un d�bat qui aurait pu se poursuivre, mais le go�ter � base de pommes de la G�tine, de tourteau fromager et de fromages de ch�vre deux-s�vriens, commen�ait � �tre loin, d'autres r�jouissances gastronomiques nous attendaient tandis que notre �lu local �tait appel� � des missions parisiennes sur des questions budg�taires� on n'oublie pas le nerf de la guerre !
Annie Bauer
Des objets symboles ...
Arriver en Poitou-charentes avec un objet qui � repr�sente le th�me de la participation citoyenne�", telle �tait notre demande en tant que collectif d'organisation. Une fa�on de percevoir la diversit�, de croiser les symboles, d'appr�cier les entr�es que chacun privil�gie dans un th�me� et nous n'avons pas �t� d��us ! Voyez les quelques exemples suivants :
R�seau de ficelles : comme symbole des relations �mises en r�seau, � faire en amont de tout projet et des relations � venir. (Afrique)
P�tition "Exploiter n'est pas jouer" : participation active du citoyen en signant une p�tition. (France)
Bouteille d'eau min�rale : illustration des enjeux des prochaines d�cennies qui sont l�approvisionnement en eau potable et le traitement des d�chets m�nagers et industriels. (France)
Atlas de Li�ge 2001 � "Un autre regard pour imaginer la ville" : il est le fruit des apports d'une centaine de li�geois qui auraient pu �tre ici. (Belgique).
Un marteau : travail sur des projets de terrain avec des jeunes de 16-25 ans que l'on sensibilise � l'environnement par le biais de ces travaux. Le marteau signifie �galement que l'on "b�tit" des citoyens soucieux de l'environnement. (Qu�bec � Canada)
Un pot de fer, un pot de terre : car la lutte des citoyens est �gale � celle du pot de terre contre le pot de fer. (Pays Basque � France)
Je n'ai pas apport� d'objet ! Je suis l� et l'implication citoyenne est avant tout humaine ! (Terre)
Elodie Le Thiec
L'exp�rience de budget participatif � Porto Alegre, par Ivan Gerardo Peyre Tartaruga
La participation citoyenne est � la base du processus qui offre le droit de participer � la d�finition du budget de la municipalit�, surtout en ce qui concerne les investissements.
L'exp�rience se d�roule � Porto Alegre, qui est la capitale politique de l'�tat du Rio Grande Do Sul, lui-m�me situ� dans la zone �conomique la plus dynamique du Br�sil.
Historiquement, le processus s'est concr�tement mis en place en 1989 avec l'�lection du Parti des Travailleurs � la t�te de Porto Alegre. La r�flexion avait d�but� d�s le d�but des ann�es 80 avec trois �v�nements marquants : la formation de l'Union des Associations de Quartiers de Porto Alegre (UAQPA), tr�s active aujourd'hui, la red�mocratisation du Br�sil apr�s 21 ans de dictature et la mise en place de la constitution f�d�rale qui a permis le raffermissement des communaut�s locales.
Le budget participatif se d�coupe en 16 secteurs avec, dans chacun, des r�unions ind�pendantes traitant les probl�mes locaux. De plus, les probl�mes globaux sont trait�s dans 6 assembl�es th�matiques : circulation et transports ; sant� et assistance sociale ; �ducation, sports et loisirs ; culture ; d�veloppement �conomique et fiscalit� ; organisation de la cit� et d�veloppement urbain. Le but principal est de rechercher des priorit�s dans le budget communal et d'investir au mieux. L�objectif �tant l'�veil � la citoyennet�. Ces priorit�s sont principalement les voies de circulation, la politique d'am�lioration du logement, l'assainissement, l'�ducation et la sant� : la majorit� des actions correspond aux besoins essentiels de la population la plus d�munie, particuli�rement investie.
Au fil des ann�es, la participation a fortement �volu�, passant de 1000 personnes en 1989 � 20000 personnes en 2001. Toutefois, les habitants ont des difficult�s � se sentir citoyens de la ville enti�re : les classes moyennes et sup�rieures ne participent pas, car peu concern�es ; les plus d�munis se d�mobilisent largement une fois leurs exigences r�alis�es.
Le processus permet la r�gulation des conflits avec une meilleure r�partition des investissements dans la ville, le recueil de meilleures informations pour des choix plus pertinents, une am�lioration du dialogue entre les habitants et la municipalit� et une transparence dans les investissements. Tout ceci entra�ne une bonne compr�hension de la gestion des budgets de la part des habitants, d'autant plus que chaque chantier est surveill� par une commission compos�e d'habitants.
Le budget participatif repr�sente 15 % du budget global de la municipalit� soit 60 000 000 $.
Pour vous, la mobilisation c'est quoi ?
Il s�agissait de rep�rer les points qui peuvent permettre de � basculer � vers la mobilisation et l�engagement, ceux qui peuvent donner de l��nergie pour se mobiliser c�est-�-dire se mettre en mouvement.
Il ressort des d�bats que les mobilisations � contre � et � pour � peuvent �tre compl�mentaires mais que si l�on souhaite travailler dans le long terme, le � pour � est plus favorable.
La notion de regroupement est primordiale. En effet, il faut �tre nombreux pour pouvoir r�ussir.
Ont �t� discut�es les notions de mobilisation DE la population par quelques-uns qui d�tiennent des solutions, ou AVEC la population qui peut alors remettre en cause le projet initial ou encore b�tir le projet en �tant associ�e au processus, voire m�me �tre l�auteur de ce processus.
Ceci a permis de d�velopper la notion d�Acteur� Auteur, plut�t que d�imposer une id�e aussi juste soit-elle !
La n�cessit� d��tablir des liens a �t� soulign�e.
Liens entre le politique et le citoyen : articuler les r�les, faire que les mobilisations (m�me si les motivations sont diff�rentes) se rencontrent, osciller toujours entre l�institu� et le normatif qui rassurent, et la remise en cause qui bouscule et permet d��voluer, mais peut faire peur.
Liens avec les m�dias : les mobiliser, les utiliser davantage, m�me si cela peut �tre � � double-tranchant � avec des diff�rences culturelles d�utilisation et de force des m�dias selon les pays !
Liens avec les personnes d�favoris�es, sans emplois, en marge� qui souvent ont du temps et pour qui la mobilisation peut avoir des vertus formatrices.
Elodie Le Thiec
PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
Lanc�s directement dans le vif du sujet : " ressources et contraintes de l'�ducation � l'environnement en milieu urbain", les participants se sont pr�sent�s et ont apport� leur �clairage � travers leurs exp�riences du Chili � Bruxelles, en passant par la Tunisie et le Qu�bec, la Guyane, Lyon et la Corse.
La phrase du jour : " il ne s'agit pas seulement de vivre mieux dans sa ville, mais de faire vivre sa ville. "
L'�ducation � l'environnement est apparue comme un facteur important d'int�gration culturelle et sociale, et l'�chelle pertinente de travail semble �tre le quartier.
Il a parfois �t� difficile d'identifier un �l�ment en tant que ressource ou contrainte pour l'�ducation � l'environnement. Toutefois, m�me si cela peut para�tre r�ducteur, les contraintes semblent �tre li�es � des probl�mes de financement, la mobilisation des �lus et des responsables administratifs plus th�orique que concr�te, la complexit� de l'espace qui en rend la ma�trise difficile.
Or cette ma�trise associ�e � la m�moire des lieux est n�cessaire pour �tre acteur du devenir de sa ville.
Les ressources, elles, r�sident dans la diversit� culturelle, celle des acteurs et des lieux.
Il est parfois difficile de passer � l'action surtout lorsqu'on sort du public habituel des scolaires. Or, pour avancer rapidement, il est vraiment n�cessaire de s'adresser directement aux adultes : on ne peut pas se permettre d'attendre 30 ans un changement de comportement et de soci�t�.
Les ateliers d'aujourd'hui nous ont permis de d�couvrir : un projet transversal des services municipaux de la ville de Marseille sur l'�co-citoyennet�, une ferme p�dagogique et un jardin �ducatif, le quartier de l'Estaque (celui de Marius et Jeannette) � travers une balade de d�couverte, un nouveau langage pour parler de la sant� gr�ce au bateau et � la mer, les exp�riences des "Petits D�brouillards" sur "L'eau dans ma ville", et enfin les liens entre
culture scientifique et �ducation � l'environnement.
L'impro du jour, � l'Estaque, la visite impromptue du " Cartoon Sardines Th��tre " et la rencontre avec la " Fine Lance Estaqu�enne ".
Le Buffet proven�al, pr�par� par un couple d'agriculteurs et d�gust� � la ferme p�dagogique, a �t� unani-mement appr�ci�, de m�me que l'accueil, au coucher du soleil dans les conteneurs de Thalassant� � l'Estaque.
RHONE - ALPES
Extrait du courant d�ERE Rh�ne-Alpes
Lundi 19 novembre : la d�couverte ...
Cette journ�e a privil�gi� les rencontres et les �changes impromptus entre les diff�rents participants. En effet, des visites et des activit�s dans les Bauges ont �t� organis�es. La visite d�une ferme baujue, d�une chocolaterie, le parcours de sentier d�interpr�tation ou encore des randonn�es � nature �, en sont quelques exemples.
Excellente mani�re de d�couvrir les initiatives locales et la beaut� des Bauges.
Les b�n�voles de la r�gion Rh�ne-Alpes
Au nombre de 21, ils se relaient depuis le d�but (et bien avant) pour l�organisation, la logistique et la pr�paration de nos repas et quel d�lice !!!!!
Elabor�s uniquement � partir de produits bio ou en provenance d�exploitants locaux, les mets sont d�licieux et nous font d�couvrir la gastronomie savoyarde.
En plus ils sont super agr�ables et indulgents quand on est en retard�
Un �norme merci !
Sylvie et Dayana
L�Education � l�Environnement au Cameroun
Les enjeux, les approches, les outils et les acteurs, constituent une premi�re collection baptis�e � Notre terre est pour demain �. Celle-ci a l�ambition de produire des livres et des documents de r�flexion sur l��ducation � l�environnement.
Dans ces documents de 36 pages, cinq contributions d�experts camerounais analysent la pratique de l�Education � l�Environnement au Cameroun et �valuent les responsabilit�s des parties prenantes de cette �ducation.
Joseph Futim
R�f�rence : � L��ducation � l�environnement au Cameroun : enjeux, approches, outils, acteurs� �, Collection Notre terre pour demain, Editions Interlignes
retour en haut de la page
|